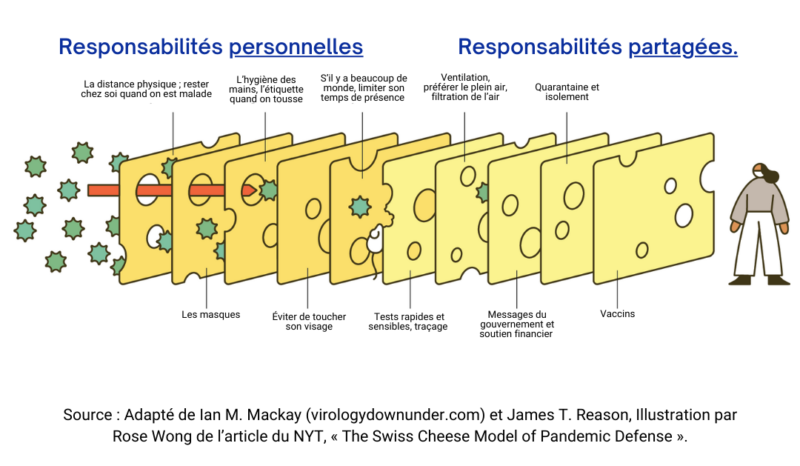L’évaluation des programmes : c’est important, les bailleurs de fonds et les donateurs la veulent… et si vous la faites vous-même, elle peut être intimidante! Chez Orchestres Canada, nous nous sommes engagés à nous améliorer en matière d’évaluation – et nous aimerions vous emmener avec nous.
Le mercredi 8 décembre 2021, Orchestres Canada a organisé un webinaire intitulé Démystifier l’évaluation des programmes dans le cadre de son Festival de l’apprentissage – Orchestres résilients de l’Ontario*. Cette séance a été présentée par Jamie Gamble, directeur de Imprint Consulting et conseiller en évaluation pour le projet Orchestres résilients de l’Ontario. Dans ce webinaire, nous apprenons ensemble de Jamie, ET nous avons une discussion franche sur la façon dont nous avons essayé d’intégrer l’évaluation dans le projet Orchestres résilients de l’Ontario, ce que nous avons appris jusqu’à présent, et comment nous appliquons nos apprentissages pour façonner le service et le soutien futurs aux membres.
Ressources (en anglais seulement) :
Une liste de ressources d’évaluation compilée par Jamie Gamble ici.
VOIR LES BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
*Le projet Orchestres résilients de l’Ontario a été conçu pour aider les orchestres à petit budget et les orchestres de jeunes de l’Ontario (groupes dont les revenus annuels, avant la pandémie, sont inférieurs à 500 000 $) à accéder à des services de consultation et à des ressources personnalisées pour les aider à planifier un retour durable aux spectacles publics dès que cela sera possible.
Ce projet est rendu possible grâce au généreux soutien de la Fondation Trillium de l’Ontario. La Fondation Trillium de l’Ontario (OTF) est un organisme du gouvernement de l’Ontario et l’une des principales fondations subventionnaires du Canada. L’an dernier, l’OTF a octroyé 108 millions de dollars à 629 projets pour favoriser l’épanouissement de communautés saines et dynamiques en Ontario.


 Le retour graduel des spectacles en personne offre aux orchestres une excellente occasion d’intégrer l’
Le retour graduel des spectacles en personne offre aux orchestres une excellente occasion d’intégrer l’